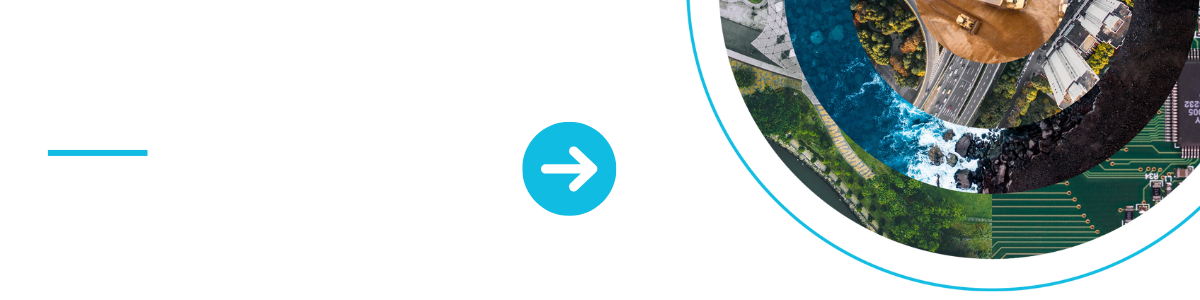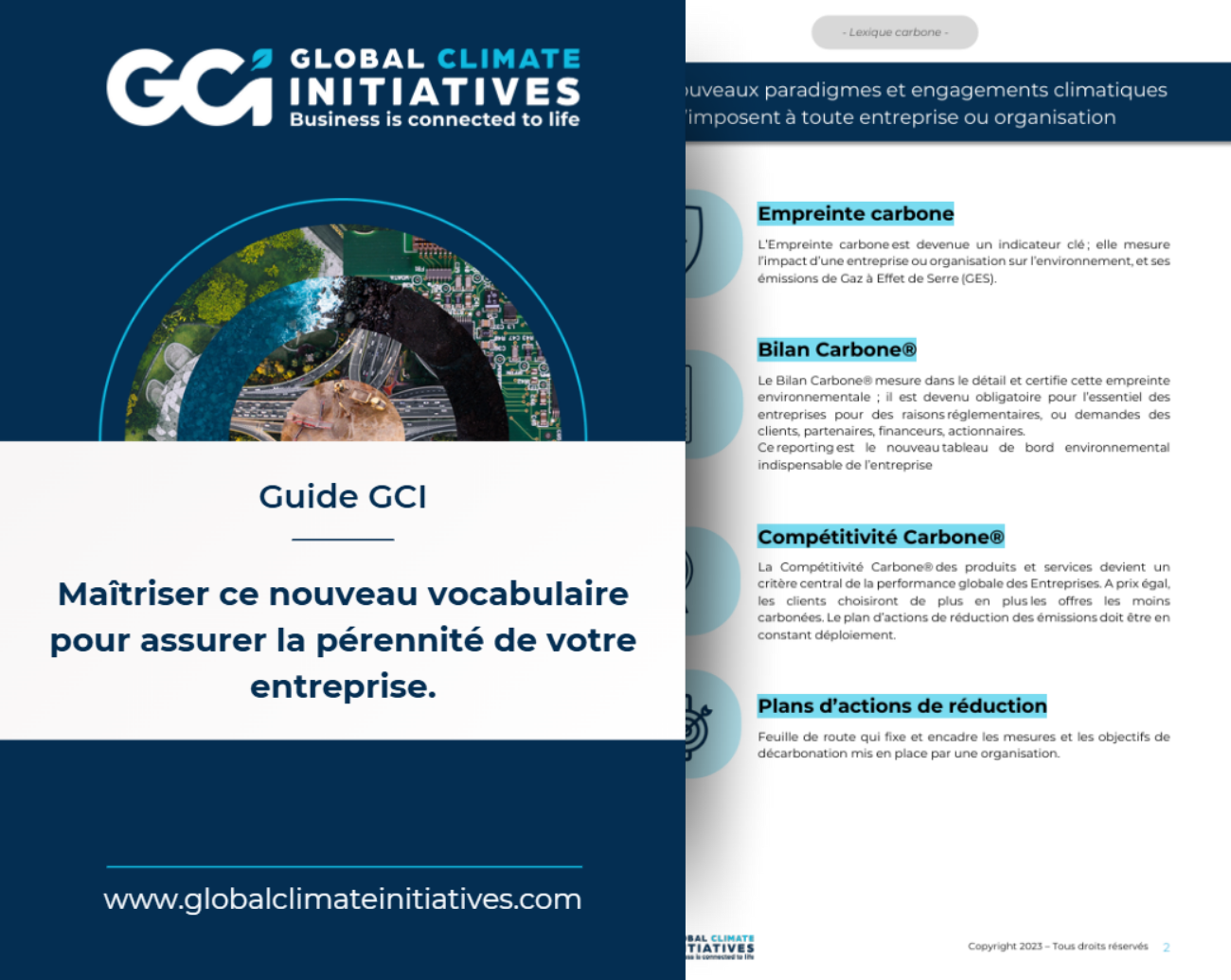Understanding GHG emissions related to real estate

The private and professional residential sector plays a decisive role in the fight against climate change. In France, it accounts for a significant proportion of GHG emissions due to heat consumption, heating methods, and the materials used in construction. Taking action on housing therefore has a direct impact on the country's carbon footprint.
Aware of this challenge, the public authorities—with the support ofADEME and the Climate and Resilience Act —have strengthened assessment and support mechanisms. The EPC, which has become an essential benchmark, identifies a property's energy and GHG class and guides policies for modernizing the residential housing stock. These tools reflect a new requirement: understanding the thermal situation of a home in order to better plan its transformation.
However, measuring is no longer enough. The climate emergency now requires concrete action: renovating, adapting, and rethinking living spaces to improve their energy efficiency. This involves implementing coherent strategies, promoting sustainable materials, and using digital solutions capable of accurately monitoring progress.
Specialized players such as Global Climate Initiatives (GCI) play a key role in this process. Through its Decarbo'Solution®, GCI supports organizations in understanding, reducing, and managing their GHG emissions, using a collaborative and scientifically-based approach. This expertise also extends to the carbon footprint of service sector companies, a key tool for measuring and reducing the climate impact of office buildings and professional digital services.
This article aims to decipher the GHGs associated with housing, analyze the levers available to improve the thermal quality and sustainability of the residential stock, and show how measurement, innovation, and cooperation can lead to a more balanced and forward-looking housing model.
Contents
The housing sector, a major lever in reducing GHGs
Understanding the role of housing in greenhouse gas emissions
In France, the residential sector accounts for nearly a quarter of greenhouse gas (GHG) emissions. A large part of these emissions come from heating, daily energy consumption, and hot water production. These factors are closely linked to the design of homes, their insulation, and the energy sources used, whether gas, electricity, or fuel oil.
Older houses and dwellings, which are often poorly insulated, are responsible for high energy consumption, leading to an increase in carbon emissions into the atmosphere. Conversely, newer, better-designed dwellings offer superior energy performance, resulting in a significant reduction in their GHG rating. This distinction between old and new dwellings illustrates the importance of modernizing the housing stock in order to achieve national carbon neutrality targets.
ADEME points out that for every building or home, reducing energy consumption can be achieved through simple actions: maintaining your heating system, insulating your attic and walls, or opting for renewable energy sources. These individual actions, multiplied on a national scale, directly contribute to reducing greenhouse gases, while improving the comfort and value of your home.
Energy performance diagnosis and GHG classes: essential benchmarks
The energy performance diagnosis (DPE) has become an essential tool for assessing the carbon performance of a home. It assigns each property a label ranging from A to G, indicating both the energy class (consumption level) and the GHG class (amount of greenhouse gases emitted). A house classified as A consumes little energy and emits few gases, while a home classified as F or G is considered energy-intensive and polluting. These classes now have a direct influence on the value of the property and on households' ability to rent or sell it.
In addition, French regulations are gradually banning the rental of the most energy-intensive housing, thereby reinforcing the importance of performance diagnostics. The EPC is based on the calculation of several parameters: the type of heating, insulation, primary energy consumption, and the use of renewable energies.
The challenge of energy performance in residential buildings
Improving the energy performance of housing is a fundamental pillar of climate policy in France. The residential stock consists of approximately 35 million units, a large proportion of which still have poor energy ratings. This means that millions of households consume too much energy and contribute to the increase in atmospheric carbon.
To reverse this trend, several levers are being mobilized:
- Energy renovation work
- Raising awareness of responsible behavior
- Financial assistance provided by the government andADEME
These efforts are part of a broader effort to modernize the sector in an environmentally friendly way. Success depends on a collective and methodical approach that involves households, communities, public enterprises, and events.
Thus, beyond simple regulatory requirements, energy performance is becoming a marker of responsibility and sustainable value. The homes of tomorrow will not only be comfortable and well insulated: they will also be energy efficient, low carbon, and designed for a more balanced planet.
Master a new vocabulary to ensure the long-term future of your company.
Calculate, understand, and act: towards low-impact housing
The GHG Balance Sheet: a snapshot of greenhouse gases
Before taking any steps to reduce greenhouse gases, it is essential to understand where they come from. The GHG balance sheet is a key tool for measuring the amount of greenhouse gases associated with each activity related to a home: heating, hot water production, building materials, travel, etc.
This calculation is based on three scopes, which enable the origin of emissions to be identified:
- Scope 1 for direct emissions (such as those related to heating or gas combustion);
- Scope 2 for indirect emissions from electricity used;
- Scope 3 for all other indirect impacts, including those related to the manufacture of materials, their CO2 emissions linked to transport, or their maintenance over time.
This tool, based on the Base Carbone® andADEME methodology, helps industry players to better identify sources of impact and develop credible reduction strategies.
From measurement to action: steering the course toward more sustainable housing
Once the measurement has been established, the next step is to define a clear roadmap. This is where the concept of a low GHG trajectory comes in, reflecting an actor's ambition to gradually reduce its emissions over time. This planning is based on analysis and simulation tools that enable the visualization of possible progress according to different scenarios.
The success of this initiative depends on a structured approach:
- Identify the primary sources of emissions (heating, hot water, materials, gas, etc.);
- Prioritize actions according to their reduction potential;
- Implement solutions tailored to the local context and available resources.
A comprehensive and collaborative approach: the Decarbo’Solution® triptych
Reducing the footprint of housing-related activities requires consideration of the entire value chain. Materials, suppliers, construction companies, local authorities, and public administrators all contribute, directly or indirectly, to greenhouse gas emissions.
To address this challenge, GCI's Decarbo'Solution® initiative offers a three-pronged integrated approach:
- Decarbo’Supply® promotes collaboration between clients and their suppliers in order to assess the environmental impact of the goods and services used. This method is based on transparency and the joint development of action plans aimed at limiting waste related to purchases and materials.
- Decarbo’Target® supports long-term planning. Using simulation tools, it helps establish a coherent roadmap that is tailored to the realities on the ground and complies with international measurement and monitoring standards.
- Decarbo’Tender® introduces a new way of integrating environmental considerations into calls for tenders. By identifying the least polluting service providers, it contributes to more responsible selection and the spread of virtuous practices within the market.
These three areas work together: measure, engage, then improve.
Our carbon footprints show that the biggest impacts of our events are linked to spectator and participant travel, as we organize popular "off-stadium" competitions.
Renovating, innovating, and cooperating for sustainable development of the residential housing stock
Towards more energy-efficient homes: renovation as a priority
Long perceived as a simple measurement tool, the EPC has now become a real driver for renovation. By identifying the GHG class and energy class of each home, it not only allows the initial situation to be assessed, but above all enables a clear path towards modernization to be defined. This assessment is now at the heart of public policy and local strategies, as it guides priorities for action and long-term investment.
The challenge goes beyond mere regulatory compliance: it is about using the EPC as a starting point for transforming the residential housing stock. The information it provides on heat loss, materials, and equipment can be used as indicators for action. It makes it possible to identify the most vulnerable homes, plan high-potential renovations, and track progress over time.
This approach makes the EPC a strategic tool for the transition to more energy-efficient housing. It enables households and public authorities to prioritize insulation, system modernization, the choice of sustainable materials, and the use of thermal efficiency solutions. Public aid, provided in particular byADEME, encourages these initiatives by supporting renovation projects and initiatives aimed at improving the thermal quality of homes.
Beyond its technical role, the EPC acts as a cultural catalyst. It changes the perception of housing: from a simple material asset, it becomes a space of collective responsibility, where each improvement contributes to reducing GHG emissions and improving the living environment.
Renovation is no longer an isolated individual effort, but a shared approach that contributes to the construction of a more sustainable, balanced, and forward-looking housing model.
Innovation as a driver of sustainable housing
The future of housing lies in a new generation of low-carbon practices and materials. The challenge is no longer limited to improving a home's GHG rating, but to designing spaces that blend harmoniously into their natural surroundings while limiting their overall footprint.
Thermal innovations play a key role in this evolution. High-performance insulation, solar control glazing, green roofs, and breathable walls reduce energy requirements while ensuring greater indoor comfort. These advances are combined with eco-intelligent management systems that can automatically adjust temperature, ventilation, and lighting according to the actual needs of occupants.
The materials used are also evolving: certified wood, raw earth, and bio-based insulation materials now play a central role in construction and renovation. Their function is not limited to strength or aesthetics: they actively contribute to thermal regulation and heat loss reduction.
Finally, the widespread use of EPCs and environmentallabels increases transparency for individuals. When selling or planning to buy a property, the energy efficiency rating becomes a key benchmark, encouraging everyone to choose the most energy-efficient homes that are the most respectful of the ecosystem.
Innovation is therefore not only measured in terms of technology, but also in the way buildings are reimagined as living organisms: places that breathe, adapt, and contribute to a sustainable balance between human comfort and environmental preservation.
Working together for a sustainable path forward
The success of an eco-responsible approach depends on cooperation between the various players in the sector: owners, large companies, associations, local authorities, and technical experts.
Each has a specific role to play in this joint effort:
- Homeowners are committed to upgrading their homes;
- Companies develop appropriate thermal and technical solutions;
- Local authorities support and finance environmental programs;
- Experts such as GCI provide reliable GHG calculation and assessment tools to guide decisions.
This collective organization creates a virtuous circle where reducing GHG emissions becomes a shared responsibility. It is based on understanding EPC data, correctly readinglabels, and gradually integrating more resource-friendly practices.
The transformation of buildings is therefore a societal issue that goes far beyond technical considerations. It involves a cultural shift, a more sustainable vision, and a desire to harmonize comfort, simplicity, and environmental responsibility.
Reducing greenhouse gas emissions in the residential sector is no longer just a regulatory requirement: it is a genuine social project. Every home, every energy performance rating, and every energy label now reflects a collective and measurable responsibility in the fight against global warming.
Supported by public policies and ADEME tools, initiatives are multiplying to help households, businesses, and communities adopt more sustainable practices. These guidelines provide a clear and accessible framework, enabling everyone to take action at their own level while participating in a national transformation process.
Energy-efficient renovations, the use of sustainable materials, and the adoption of digital management solutions are evidence of a profound change that is already underway. Beyond technical performance, it is our way of living, our conception of the value of a home, and our idea of comfort that are evolving.
Thanks to structured methodologies and innovative carbon measurement systems, industry players can now track their progress with rigor and transparency. These approaches combine scientific rigor, innovation, and a sense of community to build a more sober, smarter, and truly sustainable housing model.
Because well-designed housing today means a more balanced planet tomorrow.