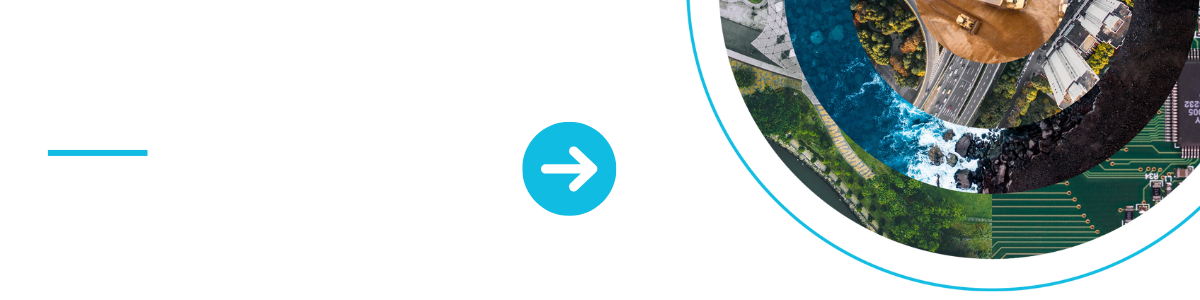Data Center Pollution: Understanding and Reducing the Carbon Footprint of Digital Technology

Every click, every email, and every online video seems intangible. Yet behind these digital useslies a very physical infrastructure: data centers. These huge storage centers, the true "hearts of the web," operate continuously to host data from around the world.
But their technological power comes at a cost. These infrastructures consume considerable amountsof energy, generating increasingly worrying levels of pollution.
According to the International Energy Agency (IEA), data centers account for nearly 1.5% of global electricity consumption and more than 2% of carbon emissions —a figure that is constantly rising with the growth of cloud computing and artificial intelligence. In France, demand for data storage and processing continues to increase, raising major questions aboutenvironmental impact.
Far from being an isolated problem in the technology sector, data center pollution now affects all businesses: every email, every file transfer, and every hosted application contributes to this invisible footprint. The carbon footprint of digital technology is therefore becoming a strategic lever in ESG policies and in the quest for more consistent sustainable development.
Faced with these challenges, digital sobriety is no longer an option. Digital players, such as user companies, must learn to measure, understand, and reduce the carbon footprint of their infrastructure.
With this in mind, solutions such as Decarbo'Solution®, developed by Global Climate Initiatives (GCI), provide a methodical and measurable approach to managing the impact of data centers and moving toward a more sustainable digital future.
Contents
Data centers: understanding their role and real-world impacts
Infrastructure essential to the functioning of the digital world
Data centers are the technical foundation of the connected economy.
They host, store, and process all data exchanged on the Internet: files, applications, videos, emails, and cloud services.
Every click, every online transaction, every request sent goes through one of these massive hosting sites.
In concrete terms, a data center houses thousands of computer servers, storage and security systems, and climate control devices to maintain a stable temperature.
Without these facilities, digital services such as social networks, collaborative tools, and online commerce would instantly cease to function.
Their role is therefore vital: they ensure the continuity of global digital communications, guaranteeing the reliability and speed of information exchanges.
But this widespread dependence comes with an increasingly visible environmental impact.
Strong growth in energy demand
Data centers require a continuous power supply to keep servers running day and night.
The proliferation of digital exchanges—videos, online services, artificial intelligence—has led to a steady increase in electricity demand.
According to the International Energy Agency (IEA), these sites currently consume around 1.5% of the world's electricity, a figure that could rise to 3% by 2030 if nothing is done to improve their efficiency.
In France, their demand is already equivalent to that of a large city such as Lyon.

This development reflects an underlying trend: the more digital technology develops, the more strategic and resource-intensive the infrastructure required for its operation becomes.
Behind the apparent immateriality of digital technology lies an industrial reality, made up of machines, maintenance, and ongoing logistics.
Controlling this consumption is therefore becoming a priority issue, for both environmental and economic reasons.
It determines the sector's ability to continue its development while limiting its ecological impact.
Multiple and often invisible ecological impacts
The environmental impact of a data center is not limited to its electricity consumption.
It includes its entire life cycle: construction, component manufacturing, logistics, maintenance, and end of service.
The construction phase is particularly material-intensive—steel, concrete, copper, aluminum— the production of which contributes to increased greenhouse gas emissions.
In addition, these facilities require large areas of land, sometimes located near already densely populated urban areas.
Water also plays a key role.
Many cooling systems use hydraulic circuits to dissipate heat, which can put additional pressure on local resources.
Operators are now seeking to limit these withdrawals through air cooling, heat recovery , orliquid immersion technologies .
Finally, the end of life of servers and electronic equipment represents another challenge.
Recycling remains partial: some components are reused, while others end up in low-efficiency treatment channels.
This contributes to the production of electronic waste, the management of which remains complex on a global scale.
A strategic challenge for businesses
Companies depend directly on this infrastructure to store and secure their data.
But this dependence also requires them to better understand their overallcarbon footprint.
More and more economic players are now measuring the footprint associated with digital hosting in order to integrate this item into their ESG approaches and sustainable development policies.
Controlling this impact is becoming a competitive advantage:
Companies that can optimize their digital flows and choose partners committed to reducing emissions enjoy a more credible image and greater resilience in the face of future regulatory constraints.
Data centers are therefore both a technical feat and an environmental challenge.
Understanding them is the first step toward developing a more sustainable model—which we will explore in the next section: why environmental pressure is intensifying and how stakeholders are adapting.
Why environmental pressure is increasing
Exponential growth puts pressure on the model
Every day, billions of digital actions are performed: emails exchanged, videos viewed, professional uses, connected applications, etc.
Behind these everyday actions, a colossal amount of information circulates and accumulates in data centers.
In less than a decade, the volume of global data has increased tenfold—a pace that few sectors can sustain.
This trend can be explained by the rise of artificial intelligence, connected objects, and streaming, as well as the widespread adoption of online working.
These services require ever more servers, space, and maintenance, putting increasing pressure on hosting sites.
For a long time, the sector's priority has been performance: greater speed, greater capacity, greater security.
But this model based on constant growth is now showing its limitations.
Increasing the number of processing centers means more resources, more built-up areas, and greater logistical requirements.
In some areas, the installation of new sites even creates strain on electricity and water networks, or competition with other industrial uses.
In light of this, several countries, including France, have begun to consider how to regulate the construction and management of these facilities.
The authorities now require projects to meet criteria for energy efficiency and better local integration.
This approach encourages digital players to design more energy-efficient structures, pool their capacities, and rethink the location of their sites in order to limit regional imbalances.
In short, the exponential growth of digital technology is no longer simply a sign of progress: it is becoming a challenge in terms of organization and collective responsibility.
Businesses, local authorities, and operators must now strike a balance between innovation, reliability, and respect for resources .
Local and societal tensions
The presence of a large data center is not insignificant for a region.
It requires specific electrical networks, powerful cooling systems, and a skilled workforce.
Some areas see the installation of these sites as a source of employment, while others see them as an additional strain on their resources.
Public debate is intensifying: how can these activities be accommodated without upsetting the local ecosystem?
In France, several local authorities now require operators to carry out detailed impact studies before any installation.
These studies assess heat discharge, land use, water management, and compatibility with development plans.
Beyond the technical aspects, these discussions raise the question of shared responsibility: that of service providers, but also of usercompanies, whose storage needs contribute to this growth.
Firstly, the use of GCI has enabled a significant reduction in the uncertainty of the GHG Balance, particularly for scope 3, from 50% to 5%. The Group now has 95% accurate data.
Thanks to supplier data collected and interpreted by the GCI tool, in-depth in-house analyses have been carried out on the impact of 35,000 products, grouping suppliers into 170 families. This represents +80% of purchases in mass and in euros.
Towards more energy-efficient data centers: levers, innovations, and support
Innovating to reduce overall impact
Digital players are no longer content with simply improving the power of their facilities: they are now seeking to limit their environmental impact.
Initiatives are multiplying around the world to design more efficient centers that combine technical reliability with ecological responsibility.
Among the most promising avenues are the design of more compact sites that are better insulated and integrated into their local environment.
The aim is to limit losses, recycle heat flows, and exploit the natural conditions of the location to stabilize internal temperatures.
In some Nordic countries, for example, proximity to sources of cold air makes it possible to reduce energy consumption without heavy technology.
Other innovations focus on recovering the heat produced, which is then reused to power neighboring buildings or public facilities.
These practices contribute to a circular economy, where the surplus from one system benefits another, thus avoiding unnecessary waste.
Measurement, the first step toward control
Rigorous monitoring is based on a structured method capable of identifying the areas of highest consumption and room for improvement.
This is where environmental analysis comes into its own.
The evaluation criteria cover the entire life cycle of the facilities: design, use, management, and end of operation.
Public authorities now encourage this approach of continuous assessment.
Regularaudits enable the commitments made by operators to be verified and the reliability of the information provided to be guaranteed.
This external control becomes a guarantee of trust for partners and end users.
Decarbo’Solution®: a tool for understanding and taking action
To support this transition, Global Climate Initiatives (GCI) offers a comprehensive approach through Decarbo’Solution®.
This platform helpsorganizations establish a precise environmentalimpact, identify their GHG emissions sources, and plan concrete reduction actions.
The tool is based on a recognized method derived from international standards (ISO 14064, ISO 14067, and GHG Protocol).
It draws on reliableinformation collected from the parties involved and transforms it into concrete levers for action.
Each company can thus visualize the impact of its activities, prioritize the most effective actions, and monitor their effects over time.
One of the major advantages of Decarbo’Solution® is its ability to link regulatory requirements, sustainability objectives, and the operational reality of organizations, based on a collaborative approach with its ecosystem, particularly its suppliers.
It is not limited to a calculation: it helps to build a coherent strategy based on measurable and audited criteria.
Data centers symbolize both the technological success of the 21st century and the challenges it poses for our planet.
Their rapid growth reveals a simple truth: every digital innovation has a physical cost, measurable in terms of our land and resources.
The question now is no longer how to limit digital growth, but how to make it compatible with ecological imperatives.
This transformation requires clear-headed choices: designing more energy-efficient facilities, better distributing usage, and objectively assessing impacts in order to act consistently.
Businesses have a key role to play in this transition by integrating emissions measurement and control into their core strategy.
In this collective effort, technology becomes a lever for progress, not a source of constraint.
This is the conviction shared by Global Climate Initiatives (GCI): to use rigorous measurement and methodological expertise to promote digital technology that is more respectful of ecological and human balances.